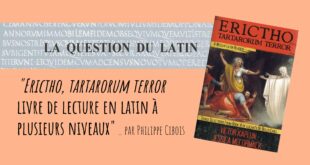Réformer le collège : quelle finalité ?
article proposé par Nicolas Tenzer
 Collegium semper reformandum : le collège doit toujours être réformé, si l’on nous permet cet usage abusif du mot latin ! Personne, en effet, ne peut penser que le collège aujourd’hui, tel qu’il fonctionne en France, ne soit pas un point noir du système éducatif et prétendre qu’il favorise aussi bien le « sauvetage » des jeunes les plus en difficulté que l’excellence des meilleurs. Il nivelle et enfonce, ne guérissant pas les maux plus lourds et ne permettant pas le développement des talents. Sans doute les plus doués s’en sortiront-ils toujours, essentiellement grâce à l’appui des familles, mais la plupart de ceux dont l’éducation ne repose que sur le collège, autrement dit surtout les plus démunis, verront là certaines lacunes ancrées pour la vie. Le collège finit par ancrer l’irrattrapable.
Collegium semper reformandum : le collège doit toujours être réformé, si l’on nous permet cet usage abusif du mot latin ! Personne, en effet, ne peut penser que le collège aujourd’hui, tel qu’il fonctionne en France, ne soit pas un point noir du système éducatif et prétendre qu’il favorise aussi bien le « sauvetage » des jeunes les plus en difficulté que l’excellence des meilleurs. Il nivelle et enfonce, ne guérissant pas les maux plus lourds et ne permettant pas le développement des talents. Sans doute les plus doués s’en sortiront-ils toujours, essentiellement grâce à l’appui des familles, mais la plupart de ceux dont l’éducation ne repose que sur le collège, autrement dit surtout les plus démunis, verront là certaines lacunes ancrées pour la vie. Le collège finit par ancrer l’irrattrapable.
Ne plaidons pas pour les réformes impossibles
Il faut donc d’urgence réformer le collège. Est-ce à dire que, pour autant, il faut mettre fin au collège unique et à ses illusions – car il n’est, de fait, pas si vraiment unique que cela sur le territoire de la République ? On pourrait certes voir tout l’intérêt pédagogique de cette solution : des classes plus homogènes qu’on pourrait parfois tirer vers le haut en faisant plus et mieux que le programme, une pédagogie renforcée dans les classes « difficiles », une souplesse plus grande qui permettrait de tenir compte des temps d’apprentissage différents.
Mais là aussi, ne soyons pas irréalistes : aller dans cette direction serait non seulement politiquement inacceptable, mais conduirait à « enfoncer » encore certaines classes en renforçant leur homogénéité sans pour autant pouvoir fonder là-dessus une pédagogie permettant d’amener les meilleurs des élèves les plus défavorisés vers l’excellence. Nous devons donc apprendre à vivre avec le collège unique tel qu’il est, en veillant même sans doute plus qu’aujourd’hui à éviter que certains établissements accueillent majoritairement les élèves les plus difficiles.
Exigence de respect, respect de l’exigence
Mais une fois qu’on a écrit cela, cela signifie-t-il, comme cela fut la pente depuis plus d’une décennie, mettre le collège au niveau – souvent plus présumé que réel de l’élève et de son potentiel, lui aussi supposé, c’est-à-dire spontanément déprécié ? Cela signifie-t-il supprimer les rédactions, bannir la lecture de textes littéraires intégraux, alléger les connaissances historiques et géographiques, supprimer les langues réputées plus difficiles comme premières langues vivantes si l’élève le souhaite, marginaliser de plus en plus l’enseignement des langues anciennes, noyer les disciplines dans du « transdisciplinaire » peu structuré, etc. ? Cela empêche-t-il d’ailleurs aussi, dans une même classe et un même établissement, de permettre aux élèves, accompagnés par les professeurs, d’avancer selon des rythmes et des vitesses différents, sans d’ailleurs que cela signifie ipso facto qu’entre celui qui avance le plus lentement, peine à bien orthographier spontanément certains mots, mémorise difficilement les déclinaisons latines, et celui qui se meut plus vite, lit plus, écrit avec aisance, connaît mieux l’histoire, il y ait toujours 15 points de différence ? La réponse est non, là aussi.
Vivre avec une différence de rythmes, de capacité d’apprentissage, de résonance des disciplines avec la culture du milieu extérieur, de reconnaissance naturelle de la valeur de certains savoirs, n’empêche pas de garder des objectifs élevés et des programmes ambitieux. Mais la question qui se trouve là posée est d’abord celle de la finalité ultime de l’enseignement, au collège en particulier.
Faisons seulement ici une rapide parenthèse, dont le rapport est d’ailleurs étroit avec la question des fins comme on le verra. On accuse le collège de mille maux, mais il ne saurait être tenu responsable de tous. Trop souvent, on fait porter au collège la faute de déficiences qui sont celles de l’enseignement primaire (passons d’ailleurs sur le fait que certains considèrent l’enseignement du premier cycle du secondaire comme la continuation de cet enseignement primaire plus que comme la préparation du second cycle). On demande au collège de rattraper ce que l’école primaire n’a pas été en mesure de réussir et, notamment, de corriger les déficiences dans l’expression française, certaines connaissances historiques de base et les règles élémentaires du calcul. Tant que cela sera le cas, le collège pâtira de devoir assumer des tâches qui ne sont pas les siennes. Ajoutons un scolie : en plus de ce transfert de charges, on lui enjoint aussi de guérir les maux sociaux, de favoriser l’égalité et même parfois de jouer le rôle de psychothérapeute. Si cette remarque est nouée à la question des finalités, c’est bien parce que, dans le cadre d’un projet global, il est essentiel d’attribuer à chaque niveau d’enseignement une part propre dans l’atteinte de celui-ci sans le divertir par des tâches qui ne sont pas de son ressort. Et ceci, naturellement, doit être clairement précisé. Suum cuique tribuere : antique règle du droit romain, qui reprend d’ailleurs un principe aristotélicien, mais qui s’applique aussi aux institutions, dont l’école.
Les deux finalités
Revenons donc aux fins substantielles de l’école. Elles sont à la fois générales et pour partie atemporelles, d’un côté, profondément ancrées dans les exigences propres à notre temps, autrement dit politiques, de l’autre. Les premières, pour aller vite, certainement trop, regroupent les savoirs fondamentaux (lecture, écriture, calcul) qui permettent d’accéder à d’autres savoirs, la connaissance de sa langue, c’est-à-dire la capacité de l’utiliser pleinement et précisément, la capacité de se situer dans le temps et l’espace, et bien sûr la faculté de penser par soi-même, cette autonomie étant condition de la liberté. Ajoutons-y, autant qu’il est possible, une certaine élévation de l’âme qui permet d’augurer que celui qui deviendra adulte sera plus probablement un être sociable et doué d’empathie. Je n’imagine pas un enseignement qui obéirait à ces objectifs ne pas comprendre, outre les savoirs de base, la littérature (ou plutôt l’apprentissage d’une pratique personnelle de la littérature), l’histoire, la géographie, les sciences et plusieurs langues. Je crois nécessaire d’y ajouter, pour le plus grand nombre possible, une connaissance de base des langues anciennes sans lesquelles une partie de notre propre langue devient indéchiffrable et notre civilisation sans racines, au-delà même de la rigueur à laquelle elles obligent et dont les sciences exactes aussi bien que l’apprentissage d’autres langues peuvent bénéficier. Il ne s’agit certes pas que chacun ni même une grosse minorité sache lire Tacite ou Thucydide dans le texte, mais qu’au moins un nombre aussi élevé que possible ait acquis une certaine familiarité avec la construction de ces langues. Ensuite, la philosophie peut être considérée comme une discipline de couronnement, car elle est l’apprentissage même de la pensée. Mais l’apprentissage de la philosophie n’a aucun sens sans connaissance historique, littéraire et, pour partie aussi, scientifique.
Les exigences propres au moment historique dans lequel nous vivons sont plus évolutives, mais sans doute ont-elles acquis une importance encore plus grande depuis quelques années. Les unes peuvent être rapidement énoncées : préparer au mieux et au meilleur niveau possible, dans le contexte d’une concurrence internationale considérablement accrue, les élèves, puis les étudiants, à l’exercice d’un emploi et, sans doute plus encore, à l’évolution dans leur emploi, car celle-ci sera de plus en plus souvent la règle. Les autres sont plus compliquées, mais je les résumerais par une expression : l’apprentissage de la faculté de résistance. C’est cela qui fait le citoyen. Celui-ci doit résister non seulement à l’envahissement de la consommation, notamment dite « culturelle », standardisée, mais aussi aux pensées imposées, aux modes, aux idéologies et aux religions extrêmes. Il doit garder des convictions fortes sur fond de scepticisme et toujours plus parvenir à se décentrer par rapport à ses déterminants sociaux et culturels. Autrement dit, l’école doit toujours permettre davantage un décentrement de soi par rapport à soi-même et à sa culture héritée. Cela suppose aussi que chacun, autant qu’il est possible, puisse juger par soi-même, analyser et critiquer. Rêve ? Non, cela ne fait qu’exprimer le projet fondateur de l’école, qui est d’abord celui des Lumières. Chaque démocrate et républicain conséquent sait qu’en une période de montée des fanatismes religieux et des idéologies de fermeture et de rejet, et devant la tentation de se claquemurer et de se fermer au dialogue avec celui qui est différent, c’est cet esprit distancié qui seul peut sauver le citoyen. Disons même que cet enjeu est vital pour notre communauté nationale, l’Europe et nos relations avec le reste du monde.
Certes, il est illusoire de charger l’école seule d’une obligation aussi lourde, mais si l’école contribue à agir contre un tel objectif, ni les familles, ni les politiques, ni les media, encore moins les intellectuels, ne pourront y parvenir. Là aussi, on trouve à l’origine d’une telle possibilité, il faut le reconnaître, les disciplines classiques : la langue maternelle qui permet de penser, mais aussi d’aiguiser la sensibilité et le jugement, l’histoire qui remet les querelles de maintenant dans une continuité historique, les sciences qui nous prémunissent contre les représentations fantasmées de l’homme et de l’univers, la géographie qui nous révèle aussi notre place dans le monde, la philosophie qui aiguise notre capacité de décalage et de question, y compris par rapport à nous-mêmes, les langues anciennes, qui nous instruisent non seulement sur quelques épisodes fondateurs de l’histoire universelle, mais nous permettent aussi de réfléchir au sens des mots, notamment politiques, que nous utilisons.
Qu’on ne nous rétorque pas que ce programme est élitiste. Cela serait, à mon sens, mépriser et injurier la capacité de progrès des enfants les plus démunis, socialement et culturellement. De nombreuses expériences ont montré que, bien motivés par des équipes respectueuses de leurs rythmes, capables de tenir un discours positif, soutenues par un discours « officiel » bien structuré, des enfants dont beaucoup désespéraient ont vite vu comme une marque de confiance et de respect qu’on les intéressât à autre chose qu’à ce à quoi ils avaient été habitués. Certes, cela ne marche pas toujours, mais il faut aller aussi loin que possible. Tel de mes camarades est parvenu à faire lire L’étrange défaite à des collégiens d’une banlieue défavorisée et à susciter des débats passionnés et passionnants. L’objectif est toujours d’élever et de rendre chacun meilleur en lui permettant d’échapper à la place que les déterminations sociologiques lui assigneraient sinon.
Surtout, dans la société telle qu’elle est et devant les défis politiques, culturels et sociaux qu’elle doit affronter et tels qu’ils viennent d’être rapidement décrits, l’élitisme sera une tragique erreur. Nous ne pouvons nous contenter d’inculquer l’apprentissage de la pensée à quelques-uns, car ils seront incapables de tenir les promesses de la République. Cet enseignement du mépris conduit à une faute politique tragique. La démocratisation de l’excellence est une nécessité absolue. Les entreprises aussi, d’ailleurs, partout dans le monde – et le mouvement s’affirme de plus en plus aux Etats-Unis devant la faillite d’un enseignement, secondaire mais aussi supérieur, dans les domaines de la connaissance non technique , réclament des cadres capables de penser par eux-mêmes, d’avoir de la distance et une capacité de remise en cause, ce qui doit s’apprendre d’abord à l’école. Les administrations aussi pâtissent d’ailleurs de cette difficulté d’un nombre accru de personnes, même au niveau supérieur, de se mettre à distance et, selon l’expression de Hannah Arendt, de penser le nouveau.
Ecole et projet politique
Je ne saurais ici conclure par un propos politique immédiat, sinon pour dire que le débat sur l’école doit non seulement échapper aux clivages politiques habituels, aux intérêts syndicaux et aux manœuvres idéologiques. Avant, en tout cas, de réformer le collège ou tout autre niveau d’enseignement, il importe que les responsables gouvernementaux, quels qu’ils soient, oublient les incantations, les mots stéréotypés et le langage convenu. Ils doivent d’abord parler des finalités, permettre qu’on en débatte avant toute autre considération, évoquer ensuite les matières et les programmes et veiller à ce qu’ils soient en concordance. J’ajouterais que la question de l’éducation tient aussi la vision qui tient celle de l’enseignement. Cette éducation est plus large et c’est aussi au politique de tracer une ligne continue entre son propos sur le citoyen, l’histoire et, singulièrement, la mémoire historique, l’idéal européen et les valeurs qu’il porte, les droits humains et la République et son objectif pour l’école. C’est au politique de dire ce qu’il espère de l’esprit public et de penser l’école en adéquation. Que l’un et l’autre s’écartent, et cela sera la faillite de l’idéal d’émancipation qui, plus que jamais, doit nous gouverner.
Nicolas Tenzer : Directeur de la revue Le Banquet, président du directoire de l’Institut Aspen France et du Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique (CERAP), conférencier international sur les questions géostratégiques et l’analyse des risques politiques, auteur de trois rapports officiels au gouvernement, dont deux sur la stratégie internationale, et de 21 ouvrages, notamment de Quand la France disparaît du monde, Paris, Grasset, 2008, Le monde à l’horizon 2030. La règle et le désordre, Perrin, 2011 et La France a besoin des autres, Plon, 2012. Il a également beaucoup travaillé et publié sur l’éducation, dont un ouvrage sous sa directionUn projet éducatif pour la France, PUF, 1989.
Twitter @NTenzer
 Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité
Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité